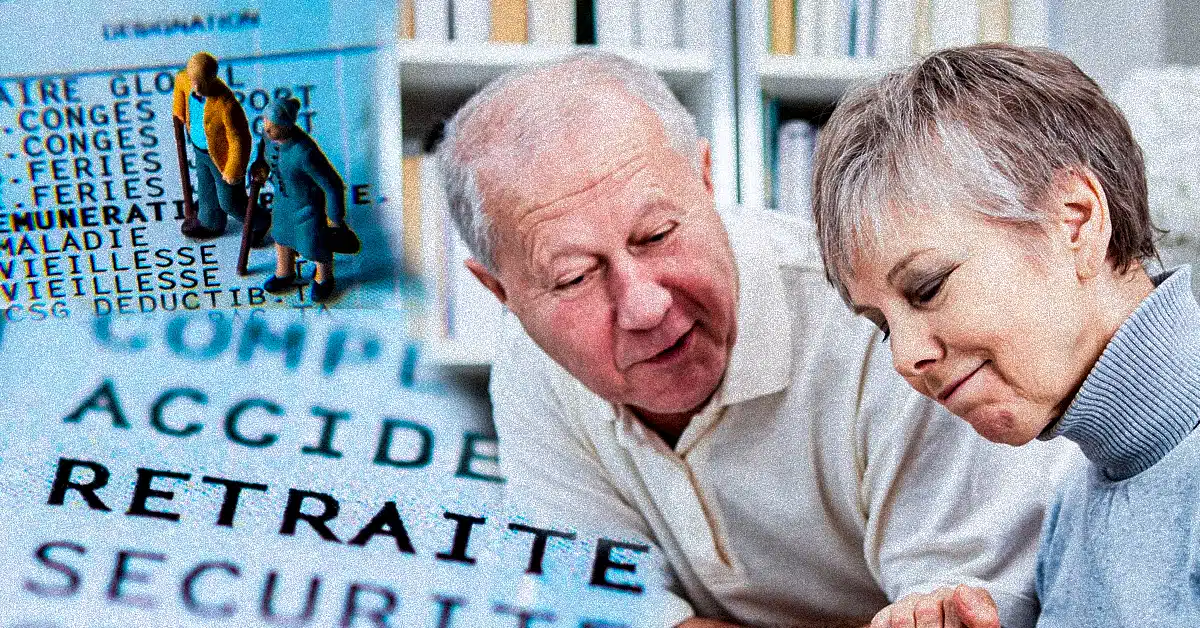Afficher le résumé Masquer le résumé
Les tensions autour de la réforme des retraites ne faiblissent pas. Plus d’un an après l’entrée en vigueur de la loi controversée, la contestation demeure vive et s’ancre dans l’opinion publique. Si les échanges entre syndicats et gouvernement se poursuivent à pas feutrés, le dialogue social semble figé, incapable d’apporter un apaisement concret.
Ce contexte tendu continue d’alimenter le débat national, relançant la question d’un éventuel retour à une solution directe par la voie populaire. Mais la pression sociale est-elle suffisante pour forcer la main à l’exécutif ? Une récente étude apporte un nouvel éclairage sur ce bras de fer politique toujours aussi inflammable.
Les chiffres révèlent un profond désaccord sur la réforme
Réalisée début avril par l’Ifop, une enquête d’opinion commandée par la CGT dévoile des résultats sans ambiguïté : près de 7 Français sur 10 (68 %) souhaitent que soit organisé un référendum sur la réforme des retraites. Le chiffre grimpe encore chez certaines catégories socioprofessionnelles : 83 % des ouvriers, 76 % des chômeurs et 73 % des salariés partagent ce souhait, témoignant d’un fort rejet dans les milieux les plus concernés.
Le rejet exprimé ne concerne pas uniquement la méthode, mais aussi le fond du texte. 61 % des personnes interrogées estiment que l’âge de départ légal devrait être rétabli à 62 ans, tandis que seuls 34 % soutiennent le maintien à 64 ans. Une infime minorité de 5 % irait jusqu’à accepter une augmentation supplémentaire de l’âge légal.
Un projet toujours largement impopulaire malgré le temps écoulé
Interrogés sur l’issue d’un éventuel scrutin, 65 % des Français voteraient pour abroger la réforme actuelle. Une opinion encore plus marquée chez les salariés (73 %), confirmant le désaveu généralisé du projet porté par l’exécutif depuis 2023. Le contexte dans lequel ces données sont publiées renforce leur portée : les négociations du “Conclave des retraites”, ouvertes récemment, piétinent. Aucune mesure concrète ne semble émerger, alimentant le sentiment d’enlisement.
Mais au-delà de l’aspect juridique ou législatif, la réforme soulève une question plus fondamentale : la capacité réelle des travailleurs à prolonger leur carrière. Une majorité de 54 % des sondés ne se projette pas en mesure de tenir un emploi à temps plein jusqu’à 64 ans. Les femmes (60 %) et les ouvriers (66 %) apparaissent les plus concernés par ce doute grandissant.
Les Français privilégient d’autres leviers pour pérenniser le système
Le rejet de cette réforme ne signifie pas un rejet du système en lui-même. Les citoyens se disent prêts à envisager d’autres moyens pour assurer la viabilité du modèle de répartition. Parmi les pistes préférées figurent : l’égalité salariale entre femmes et hommes (86 % de soutien), la taxation des dividendes (82 %), et une hausse des cotisations patronales (76 %).
Pension La baisse de vos pensions inexpliquées ? Que se passe-t-il réellement sur vos comptes
En revanche, le modèle par capitalisation, souvent cité comme alternative, est loin de convaincre. Seuls 29 % des Français lui accordent leur confiance. La méfiance est particulièrement marquée chez les ouvriers, dont 70 % rejettent fermement cette option. Les récentes pertes enregistrées par les retraités américains, dont les pensions sont adossées aux marchés, n’ont fait qu’alimenter la défiance.
Un modèle de solidarité encore défendu… mais pour combien de temps ?
Malgré les critiques récurrentes, la majorité des Français continue de défendre le principe d’un système intergénérationnel. La solidarité, au cœur du modèle de retraite par répartition, reste un pilier de l’opinion publique. Pourtant, certaines voix libérales affirment que ce modèle serait dépassé, notamment face aux mutations démographiques du pays. La confrontation entre ces visions rend le débat plus complexe qu’un simple affrontement politique. La prochaine étape pourrait bien venir des urnes…